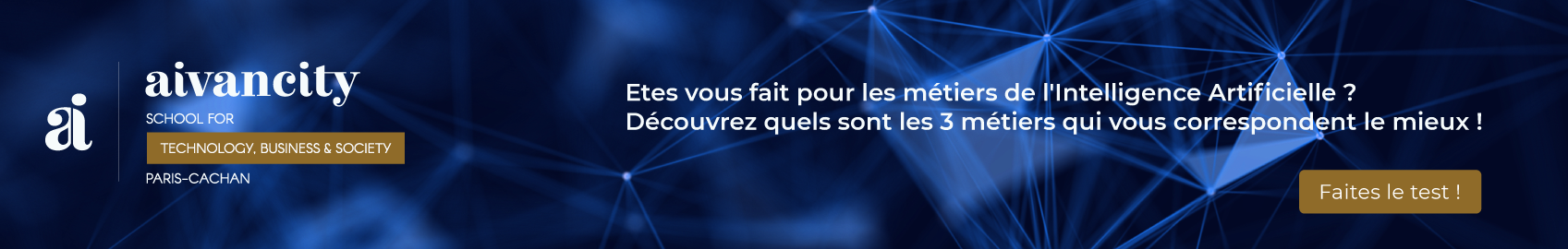Aux frontières de la science et de l’océan : une nouvelle ère pour la conservation marine
La protection de la biodiversité marine représente aujourd’hui un défi global, particulièrement aigu dans les écosystèmes fragiles des océans. En Polynésie française, les baleines à bosse, espèces migratrices emblématiques, sont confrontées à des pressions croissantes : trafic maritime, pollution sonore, réchauffement des eaux, ou encore perturbation de leurs zones de reproduction. Face à ces enjeux, l’Intelligence Artificielle (IA) s’impose comme un outil stratégique au service de la conservation des cétacés.
Le projet Ocean IA, porté par une collaboration entre chercheurs, ingénieurs et biologistes marins, illustre cette convergence entre science des données et écologie. Grâce à l’analyse d’enregistrements acoustiques, à la modélisation des comportements migratoires et à la détection automatisée de signaux biologiques, l’IA permet d’améliorer la surveillance, d’anticiper les risques et de soutenir la prise de décision en matière de protection des espèces.
Cet article propose une analyse approfondie des apports concrets de l’intelligence artificielle à la préservation des baleines en Polynésie. En s’appuyant sur des cas d’usage récents, des données scientifiques et des considérations éthiques, il met en lumière les promesses (mais aussi les limites) d’une approche technologique au service du vivant.
Un écosystème en tension face à des menaces multiples
La Polynésie française constitue l’un des derniers sanctuaires naturels pour les baleines à bosse de l’hémisphère sud. Chaque année, entre juillet et novembre, ces cétacés quittent les eaux froides de l’Antarctique pour venir se reproduire et mettre bas dans les lagons polynésiens. Toutefois, cet équilibre fragile est aujourd’hui menacé par une combinaison de facteurs anthropiques et climatiques.
Le trafic maritime constitue l’un des dangers majeurs pour ces espèces. Le nombre croissant de navires de plaisance, de cargos ou de croisières dans les zones de passage des cétacés augmente le risque de collisions, parfois mortelles1. La pollution sonore, quant à elle, perturbe les communications acoustiques des baleines, essentielles à leur reproduction et à leur orientation2. S’y ajoutent les perturbations causées par les activités touristiques non régulées, les polluants chimiques et les effets du réchauffement des eaux sur les chaînes trophiques.
Face à ces menaces multiples, les méthodes traditionnelles de suivi et de recensement (observations visuelles, marquage satellite, enregistrements manuels) peinent à couvrir efficacement des territoires marins aussi vastes que ceux de l’archipel polynésien. Le besoin d’outils d’analyse plus performants, capables de traiter des volumes de données importants en temps réel, s’impose avec acuité.
Ocean IA : capteurs, données et algorithmes au chevet des cétacés
Le projet Ocean IA est né d’un partenariat entre des institutions océanographiques, des laboratoires en intelligence artificielle et des ONG environnementales locales. Son objectif : développer un système intelligent de surveillance acoustique marine permettant de détecter, d’identifier et de suivre les cétacés de manière non intrusive.
Des réseaux d’hydrophones (microphones sous-marins) installés dans les zones de passage fréquent des baleines enregistrent en continu les sons ambiants. Ces données, massives et complexes, sont ensuite traitées par des modèles d’apprentissage automatique capables de distinguer les chants des baleines des bruits de fond, de les attribuer à des espèces spécifiques et de prédire leurs trajectoires probables3.
Cette approche permet de constituer une base de données dynamique et évolutive des présences, comportements et déplacements des cétacés, essentielle pour orienter les politiques de conservation, alerter les navires et sensibiliser les populations.
IA en action : prédire, protéger, prévenir
Plusieurs cas d’usage récents illustrent l’efficacité de l’IA dans ce contexte :
- Détection en temps réel : en analysant les signaux acoustiques captés en mer, le système est capable de repérer la présence de baleines dans un rayon de plusieurs kilomètres. Ces détections sont automatiquement transmises aux autorités maritimes, qui peuvent alors recommander des modifications de trajectoire ou de vitesse aux navires en approche.
- Cartographie dynamique : les données agrégées permettent de produire des cartes actualisées des zones de forte activité cétacée, utilisées pour ajuster temporairement les routes maritimes ou interdire certaines activités nautiques dans les périodes critiques4.
- Prévision des migrations : grâce à des modèles prédictifs fondés sur les données historiques et environnementales (température de l’eau, salinité, saisons), il est possible d’anticiper les périodes et lieux de présence accrue des baleines, et de mettre en place des mesures préventives.
Un potentiel technologique à manier avec rigueur
L’intégration de l’IA dans les stratégies de préservation marine présente de nombreux avantages : traitement de grandes masses de données, détection rapide et précise, réduction du coût humain de surveillance en mer, amélioration de la réactivité opérationnelle. Elle permet également d’éviter des approches intrusives ou stressantes pour les animaux.
Cependant, ces technologies ne sont pas exemptes de limites. Leur efficacité dépend fortement de la qualité et de la quantité des données collectées. Les modèles peuvent aussi produire des erreurs de classification ou des faux positifs, notamment lorsqu’ils sont confrontés à des bruits marins inconnus. Par ailleurs, l’interprétation des résultats nécessite l’expertise croisée de data scientists et de biologistes, soulignant la nécessité d’une approche interdisciplinaire5.
Gouvernance, transparence et souveraineté : les défis éthiques de l’IA environnementale
L’utilisation de l’IA en environnement soulève aussi des questions éthiques et réglementaires. La collecte de données maritimes, même passives, peut entrer en conflit avec des droits locaux, notamment en matière de souveraineté des eaux ou de respect des territoires autochtones.
De plus, la délégation de certaines décisions à des systèmes automatisés (détection, alerte, fermeture de zones) pose la question de la responsabilité : qui est comptable des conséquences en cas d’erreur ou d’inaction ? Enfin, comme tout système algorithmique, les outils utilisés doivent faire l’objet d’audits réguliers pour éviter les biais et garantir leur transparence.
Et si l’IA devenait un pilier de la diplomatie océanique ?
La protection des baleines en Polynésie s’inscrit désormais dans un dialogue étroit entre biologie, informatique et éthique. L’intelligence artificielle, loin d’être une solution miracle, s’impose comme un outil puissant au service d’une vision renouvelée de la conservation marine. Dans les décennies à venir, pourrait-elle devenir un pilier d’une diplomatie environnementale internationale, fondée sur la connaissance partagée des océans et des espèces qui les habitent ?
Pour aller plus loin
Pour élargir la réflexion sur l’IA au service de la protection environnementale, découvrez TerraMind : Intelligence artificielle et observation de la Terre, un article du blog aivancity qui explore comment l’IA, via l’analyse de données géospatiales satellites, aide à surveiller les écosystèmes, à suivre la pollution et à anticiper les risques naturels
Références
1. UK launches £225m Isambard-AI supercomputer in Bristol – BBC News, 15 juillet 2025
https://doi.org/10.1002/fee.2040
2. Dunlop, R.A. (2016). The effect of vessel noise on humpback whale communication. Ecology and Evolution, 6(9), 2956–2970.
https://doi.org/10.1002/ece3.2060
3. Gillespie, D. et al. (2020). AI-based detection and classification of cetacean sounds. Journal of the Acoustical Society of America.
https://doi.org/10.1121/10.0001172
4. Comtet, T. et al. (2023). Oceans et IA : vers une gestion dynamique de la biodiversité marine. IFREMER Report.
https://wwz.ifremer.fr/
5. CLavorel, S. & Villeneuve, B. (2022). Écologie numérique et gouvernance des données environnementales. Revue Natures Sciences Sociétés.
https://doi.org/10.1051/nss/2022010