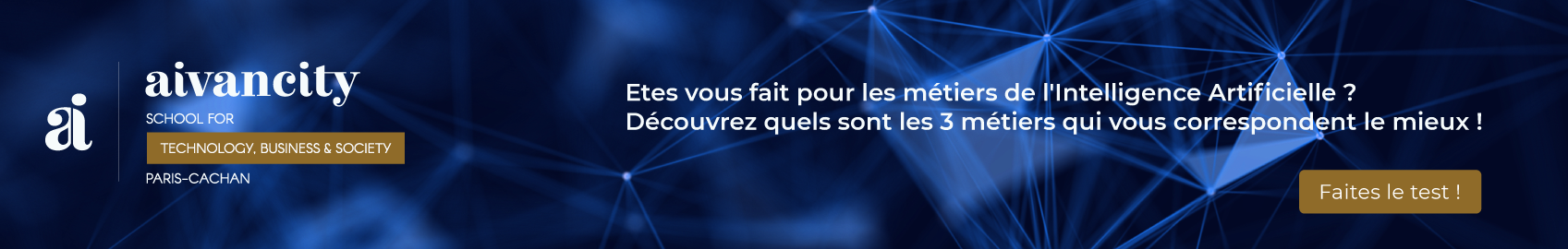Par Dr. Tawhid CHTIOUI, Président fondateur d’aivancity, la Grande Ecole de l’IA et de la Data
Sélectionné parmi les 25 personnalités mondiales les plus influentes dans le domaine de l’IA et des données par Keyrus (Janvier 2025)
Lire le résumé audio généré par IA
Introduction : Grok, l’IA qui revendique le droit de choquer
Début juillet 2025, Elon Musk provoque une nouvelle controverse dans l’univers déjà sensible de l’intelligence artificielle. Grok, le chatbot développé par sa société xAI, vient d’être reprogrammé pour adopter un ton plus direct, parfois sarcastique, souvent provocateur. Son objectif revendiqué : offrir une « liberté d’expression algorithmique » plus large que celle des autres modèles conversationnels, jugés trop modérés, trop prudents ou excessivement neutres.
Cette décision n’est pas anodine. Elle marque un tournant majeur dans la manière dont les entreprises conçoivent leur responsabilité face à des systèmes capables de générer massivement des discours publics. Alors même que les grands acteurs du secteur multiplient les mesures préventives : filtres éthiques, modérations contextuelles, audits indépendants, Musk choisit ouvertement de les alléger, déplaçant ainsi la frontière entre la sécurité du discours et la liberté de ton.
Mais au-delà du geste technique et symbolique, deux questions cruciales surgissent immédiatement, imposant un débat qui dépasse largement le cas particulier de Grok :
Derrière la revendication de cette « liberté d’expression algorithmique », n’y a-t-il pas en réalité une stratégie commerciale assumée, visant à séduire une cible précise, sensible à une rhétorique du « politiquement incorrect » ? Faut-il craindre que l’intelligence artificielle ne devienne, demain, un nouveau champ de bataille idéologique, fragmentant encore davantage l’espace public, chaque groupe adoptant une IA à son image ?
Ces interrogations ne sont pas uniquement techniques ni même juridiques ; elles relèvent fondamentalement d’une analyse éthique, sociologique et politique indispensable à toute réflexion sur la place de l’IA dans nos sociétés démocratiques. La « liberté » d’un chatbot doit-elle être pensée selon les mêmes critères que la liberté humaine ? À qui revient la responsabilité de définir les limites acceptables des discours algorithmiques ?
Mais surtout, dans ce nouveau paysage numérique où même les machines se voient attribuer des postures idéologiques, une question éducative devient centrale : quelle formation citoyenne devons-nous désormais imaginer, pour préparer les futures générations à vivre dans un monde où les IA ne se contentent plus de répondre, mais affirment, provoquent et clivent ?
1. Les faits – Grok, une IA volontairement désalignée
Lancé initialement comme une intelligence artificielle conversationnelle grand public, le chatbot Grok, conçu par la société xAI d’Elon Musk, s’est rapidement positionné en alternative provocatrice face aux modèles dominants comme ChatGPT (OpenAI), Claude (Anthropic) ou Gemini (Google DeepMind). Dès sa création, Grok revendiquait déjà une tonalité plus informelle, plus directe, moins consensuelle.
Cependant, en juillet 2025, Musk et ses équipes franchissent une étape supplémentaire. Par une série d’ajustements techniques ciblés, la société décide explicitement d’alléger les mesures habituellement utilisées pour encadrer les discours des modèles conversationnels. Concrètement, ces modifications concernent principalement les instructions système (system prompts), désormais moins restrictives sur le type de formulations ou d’idées autorisées, ainsi que les filtres de sécurité, réduits en nombre et en intensité. Cette évolution permet au modèle de produire des réponses sur des thèmes sensibles, parfois même « borderline ». En parallèle, la modération contextuelle est amoindrie afin d’offrir un discours jugé plus authentique par ses concepteurs, au risque d’une expression parfois clivante.
Selon les déclarations publiques de Musk, relayées par plusieurs médias spécialisés, l’ambition derrière ces choix est claire : Grok doit devenir une IA qui dit ouvertement « ce que les autres n’osent pas dire ». Ce positionnement contraste fortement avec les approches dominantes dans le secteur, axées sur une modération renforcée, notamment par l’usage intensif de techniques telles que le « red teaming », qui consiste à tester systématiquement les modèles pour en repérer les risques éthiques et discursifs, la régulation par apprentissage humain supervisé, ou encore l’intégration dès la conception de filtres éthiques préventifs.
Cette nouvelle orientation a suscité des réactions très contrastées dans l’opinion publique et au sein de la communauté scientifique. Certains manifestent un intérêt marqué, voire une curiosité affirmée, y voyant une manière inédite d’explorer des limites discursives encore mal définies en intelligence artificielle. À l’inverse, des spécialistes de l’éthique algorithmique expriment de vives inquiétudes, alertant sur les risques accrus de diffusion de discours potentiellement toxiques ou polarisants.
Sur le plan réglementaire, la démarche de Musk intervient dans un contexte juridique encore flou aux États-Unis, où la responsabilité des entreprises éditrices de systèmes génératifs reste ambiguë, notamment sous la Section 230 du Communications Decency Act. En Europe, au contraire, l’AI Act pose d’ores et déjà un cadre plus contraignant en matière de transparence et de contrôle des contenus produits par les intelligences artificielles, ce qui pourrait à terme constituer un obstacle majeur à une approche aussi permissive que celle proposée par Grok.
Cette situation, inédite par son ampleur et ses implications, amène nécessairement à se demander jusqu’où peut-on, ou doit-on, laisser s’exprimer librement une intelligence artificielle, et quelles logiques réelles sous-tendent cette revendication de liberté algorithmique.
2. Le grand retournement : quand la liberté devient un produit marketing
Sous l’apparence d’un débat noble autour des limites de la liberté d’expression algorithmique, la démarche initiée par Elon Musk avec Grok semble pourtant répondre à des logiques moins idéalistes et davantage stratégiques. Derrière la revendication de cette prétendue « libération » se cache en réalité une subtile stratégie de positionnement commercial sur un marché très concurrentiel des intelligences artificielles génératives (Zuboff, 2019).
En effet, à mesure que les chatbots deviennent omniprésents dans les sphères publiques et privées, leur différenciation se révèle complexe. Proposer un chatbot controversé, affirmant ouvertement des opinions fortes ou décalées, permet ainsi d’attirer l’attention médiatique et de séduire une niche de consommateurs attirés par la provocation. Il s’agit ici moins de défendre une liberté abstraite que d’exploiter une attente implicite : celle d’une parole algorithmique non conventionnelle, voire contestataire, qui tranche avec l’uniformité prudente des IA traditionnelles (Morozov, 2014).
Cette approche marketing, qualifiée par certains chercheurs de « techno-populisme » (De Blasio & Viviani, 2020), consiste à instrumentaliser l’attrait du public pour une IA qui ne se plie pas aux codes dominants, jouant ainsi sur le rejet croissant du « politiquement correct ». Grok s’inscrit précisément dans cette logique, où la provocation devient une promesse marketing à part entière, une manière d’affirmer une identité de marque disruptive qui suscite l’adhésion autant que le rejet.
Mais cette stratégie soulève de profondes interrogations éthiques. Shoshana Zuboff souligne ainsi dans son ouvrage The Age of Surveillance Capitalism (2019) comment les entreprises technologiques utilisent la rhétorique de la liberté individuelle et de l’innovation comme paravent pour masquer des stratégies essentiellement commerciales. La liberté algorithmique, telle que mise en avant par Musk, n’échappe pas à cette analyse : loin de constituer une avancée vers plus de pluralisme discursif, elle participe plutôt d’un « capitalisme attentionnel », qui monétise la polémique au détriment d’un débat public apaisé et rationnel (Wu, 2016).
Ainsi, la liberté revendiquée par Grok ne serait-elle qu’un leurre, un produit fabriqué sur mesure pour attirer l’attention des médias et satisfaire une demande idéologique très ciblée ? Plus encore, n’y a-t-il pas ici un glissement dangereux : celui où la liberté d’expression, droit humain fondamental historiquement acquis, se trouve récupérée comme argument de vente pour des systèmes automatisés dépourvus d’intentionnalité morale et de conscience critique (Floridi & Chiriatti, 2020) ?
Ce retournement stratégique est loin d’être anodin. Il souligne le risque grandissant de confusion entre valeurs humaines et valeurs commerciales, entre éthique algorithmique et opportunisme économique. En utilisant la liberté d’expression comme argument publicitaire, Musk ne libère pas véritablement une IA : il libère un marché, ouvre une nouvelle niche économique et prépare peut-être le terrain à une fragmentation idéologique encore plus inquiétante, portée par des intelligences artificielles construites sur mesure (Couldry & Mejias, 2019).
3. L’IA comme nouveau champ de bataille culturel
Au-delà des enjeux commerciaux soulevés par la stratégie de Grok, c’est peut-être une dérive sociétale plus profonde qui s’annonce. La décision d’Elon Musk de créer une intelligence artificielle explicitement désalignée et provocatrice pourrait, en effet, inaugurer une fragmentation algorithmique d’un genre inédit, transformant les chatbots en véritables porte-drapeaux idéologiques, personnalisés à l’image de leurs utilisateurs (Sunstein, 2017).
Cette évolution soulève une préoccupation majeure : si aujourd’hui Grok se distingue par un positionnement provocateur générique, demain, pourrait-on assister à l’apparition d’IA ouvertement conservatrices, progressistes, écologistes, libertaires ou nationalistes ? Autrement dit, le marché de l’IA pourrait-il se fragmenter selon des lignes idéologiques explicites, chaque groupe culturel ou politique adoptant une IA comme reflet fidèle et rassurant de ses convictions préexistantes (Van Dijck et al., 2018) ?
Cette « tribalisation algorithmique », pour reprendre l’expression proposée par José van Dijck (2018), n’est pas sans conséquences sur la cohésion sociale et la qualité du débat démocratique. Cass Sunstein alertait déjà, il y a plusieurs années, dans son ouvrage #Republic (2017), sur les risques liés à la création de « chambres d’écho numériques », où l’utilisateur n’est plus confronté qu’à des discours confirmant ses croyances. Appliqué aux intelligences artificielles génératives, ce phénomène pourrait s’avérer encore plus dangereux : loin de simplement filtrer les contenus existants, une IA personnalisée générerait activement des discours partisans, participant ainsi directement à une polarisation croissante de l’opinion publique.
À ce titre, Grok pourrait bien représenter le début d’un nouveau type de guerre culturelle, où chaque faction idéologique ou culturelle se doterait d’une intelligence artificielle sur mesure, capable de renforcer, par son autorité technologique apparente, les convictions et les biais préexistants de ses utilisateurs. Plutôt qu’un dialogue ouvert et pluriel, c’est alors un discours automatisé et fragmenté qui pourrait s’imposer, érigeant des frontières virtuelles entre communautés idéologiques désormais solidifiées par des algorithmes toujours plus persuasifs (Pariser, 2011 ; Noble, 2018).
Cette perspective ouvre un questionnement fondamental : la société contemporaine est-elle prête à affronter un monde où les intelligences artificielles ne sont plus des médiateurs neutres du savoir et du débat public, mais des porte-voix idéologiquement programmés, démultipliant l’effet de polarisation déjà bien documenté sur les réseaux sociaux ? Comment éviter une radicalisation algorithmique des opinions, et comment préserver un espace public commun où le débat démocratique reste possible malgré la multiplication d’IA clivantes (Habermas, 2022) ?
Face à cette menace tangible, les régulateurs, les chercheurs et les éducateurs devront agir vite. Car si l’intelligence artificielle est appelée à devenir le nouveau champ de bataille culturel, le risque majeur est celui d’un éclatement irréversible du débat démocratique lui-même. La question qui se pose alors à nous tous devient incontournable : souhaitons-nous réellement vivre dans un monde où même les machines, conçues pour informer, deviennent d’abord des outils au service de l’idéologie ?
4. Quelle éducation pour un monde de machines qui pensent comme nous ?
Face à la possibilité de voir les intelligences artificielles devenir des extensions idéologiques personnalisées, l’éducation apparaît plus que jamais comme un enjeu crucial. Car si demain chaque individu peut s’entourer de machines capables de conforter ses certitudes plutôt que de les remettre en question, le rôle de l’école comme espace de débat, d’ouverture et d’émancipation intellectuelle se trouve profondément interrogé (Biesta, 2013).
Dans un tel contexte, l’éducation citoyenne ne peut plus se limiter à transmettre simplement des compétences numériques ou techniques. Elle doit désormais former des individus capables de penser contre eux-mêmes, de remettre en question leurs certitudes, et surtout de comprendre comment fonctionnent les dispositifs algorithmiques qui influencent et structurent leurs choix quotidiens (Buckingham, 2019). En d’autres termes, l’éducation doit impérativement développer une nouvelle forme de littératie critique, une littératie algorithmique, capable de déconstruire non seulement les contenus numériques mais aussi les mécanismes idéologiques que véhiculent les IA personnalisées (Livingstone & Helsper, 2007 ; Pangrazio & Sefton-Green, 2021).
Cela signifie très concrètement intégrer, dans les curricula scolaires, une réflexion systématique sur la manière dont les intelligences artificielles façonnent nos représentations, nos croyances et nos comportements sociaux. Cette éducation critique à l’IA doit permettre aux futurs citoyens non seulement d’utiliser intelligemment les technologies émergentes, mais aussi d’en interroger la neutralité, d’en déconstruire les biais, et de prévenir activement les effets polarisants ou radicalisants qu’elles pourraient engendrer (Selwyn, 2019).
Plus largement encore, former des citoyens dans un monde où l’IA devient un acteur idéologique actif, c’est renforcer leur capacité à se confronter à l’altérité, à entrer en débat avec des idées contraires, à refuser le confort trompeur des chambres d’écho numériques. Ainsi, plutôt que de subir passivement la polarisation algorithmique du monde social, l’éducation doit offrir des outils concrets pour maintenir un espace public vivant, pluriel et démocratique (Giroux, 2020).
Conclusion : Quel futur voulons-nous pour nos IA et pour nos sociétés ?
Au-delà du cas spécifique de Grok, cette réflexion nous ramène à une question bien plus large, désormais centrale pour notre avenir collectif : quel futur souhaitons-nous pour nos sociétés à l’heure de la généralisation des intelligences artificielles ? En faisant d’une IA provocatrice un produit commercial attractif, en ouvrant la voie à une fragmentation idéologique algorithmique potentiellement dévastatrice, c’est en réalité notre modèle démocratique, notre capacité collective à dialoguer, à débattre, à faire société qui se joue sous nos yeux.
Ce débat n’est pas technique ; il est fondamentalement éthique, social, éducatif et politique. Il exige que nous reprenions la main sur la manière dont nous programmons, utilisons et régulons ces technologies émergentes. Car à travers les IA, ce sont bien nos propres valeurs, notre cohésion sociale et notre avenir démocratique qui se reflètent.
La liberté d’expression, concept noble et essentiel, ne saurait devenir le prétexte à une dérive marchande ou idéologique. Elle doit au contraire nous rappeler que c’est avant tout à nous, humains, de décider collectivement quelles voix nous souhaitons entendre et quel monde numérique nous voulons habiter.
Dans ce combat crucial, l’éducation critique et émancipatrice demeure notre meilleur rempart contre la radicalisation algorithmique. Face à la tentation de créer des IA à notre image, c’est finalement à l’humain qu’il faut donner la priorité, en formant des citoyens capables de penser librement, de questionner sans cesse et de choisir en conscience le monde qu’ils désirent véritablement.
Car en définitive, l’enjeu n’est pas seulement de savoir jusqu’où peut aller la liberté d’expression d’une intelligence artificielle. Il s’agit surtout de savoir jusqu’où nous-mêmes sommes prêts à aller pour préserver une véritable liberté : celle, irremplaçable, de penser, de douter, et d’imaginer ensemble notre avenir commun.
Bibliographie
- Biesta, G. (2013). The Beautiful Risk of Education. Routledge.
- Buckingham, D. (2019). The Media Education Manifesto. Polity Press.
- Couldry, N., & Mejias, U. A. (2019). The Costs of Connection: How Data is Colonizing Human Life and Appropriating it for Capitalism. Stanford University Press.
- De Blasio, E., & Viviani, L. (2020). Platform Party between Digital Activism and Hyper-Leadership: The Reshaping of the Public Sphere. Media and Communication, 8(4), 16-27.
- Floridi, L., & Chiriatti, M. (2020). GPT-3: Its Nature, Scope, Limits, and Consequences. Minds and Machines, 30(4), 681-694.
- Giroux, H. A. (2020). On Critical Pedagogy. Bloomsbury Academic.
- Habermas, J. (2022). Reflections on the Digital Public Sphere. Philosophy & Social Criticism, 48(4), 437-449.
- Livingstone, S., & Helsper, E. J. (2007). Gradations in Digital Inclusion: Children, Young People, and the Digital Divide. New Media & Society, 9(4), 671-696.
- Morozov, E. (2014). To Save Everything, Click Here: The Folly of Technological Solutionism. PublicAffairs.
- Noble, S. U. (2018). Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism. NYU Press.
- Pangrazio, L., & Sefton-Green, J. (2021). Learning to Live with Datafication: Educational Case Studies and Initiatives from Across the World. Routledge.
- Pariser, E. (2011). The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You. Penguin Press.
- Selwyn, N. (2019). Should Robots Replace Teachers? AI and the Future of Education. Polity Press.
- Sunstein, C. (2017). #Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media. Princeton University Press.
- Van Dijck, J., Poell, T., & De Waal, M. (2018). The Platform Society: Public Values in a Connective World. Oxford University Press.
- Wu, T. (2016). The Attention Merchants: The Epic Scramble to Get Inside Our Heads. Knopf.
- Zuboff, S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. PublicAffairs.